BESSON M’A TUER… MON CINÉMA
Pour une année qui s’annonce riche en évènements dans la vraie vie (Irak, Al Quaida, économie, retour de le lutte des classes, quelle gauche ?, quelle révolution ?, un nouveau Houellebecq peut-être, etc) il semblait juste de remettre les pendules à leur place pour celui qui est devenu le chantre du cinéma commercial français. À l’américaine.
Besson n’est pas un cinéaste, c’est un compileur, une éponge qui restitue à un public sec de rêves et d’aventures le pauvre jus qu’il aura pris la peine d’absorber dans dix autres productions.
Besson n’a rien d’un cinéaste français et le plus ses films, ou ceux qu’il produit (de toutes façons c’est toujours la même poutine) sortent, le plus ils perdent leur éventuelle touche locale. Bien sûr, Le dernier combat en noir et blanc et sa célèbre pluie de poissons avait des vertus presque ‘nouvelle vague’ d’anticipation, mais très vite le barbu s’est porté sur une version hollywoodienne, au sens le plus général et accepté du terme, d’un cinéma de divertissement exempt de toute forme de créativité et de regard sur son temps. C’est là une des raisons de son succès prévisible. Besson reçoit la bénédiction des masses de façon régulière pour son implacable adéquation avec les stimuli immédiats de populations jeunes, faciles à combler dans leur désir de satisfaction vécu par le prisme de la consommation.
Le cinéma de Besson (soyons agréable et considérons que cela en soit) fonctionne comme un pur produit marketing et ne tient compte à aucun moment des règles qui régissent ce qu’on appelait autrefois le septième art. A-t-on jamais lu un scénario digne de ce nom dans un film de Besson, a-t-on jamais été surpris par le déroulement d’un de ses récits, avons-nous jamais été bouleversé (excepté par Parillaud dans Nikita) par un de ses acteurs ? Jamais, car Besson met exactement les choses à leur place, dans le petit compartiment destiné à chaque paramètre de ce qu’il appelle du cinéma. Besson n’est pas un cinéaste, c’est un compileur, une éponge qui restitue à un public sec de rêves et d’aventures le pauvre jus qu’il aura pris la peine d’absorber dans dix autres productions.
Prenez Le cinquième élément : une louche de Taxi Driver, une pincée de Star Wars, une giclée de Metropolis, un sceau de Blade Runner, etc., pour finir par obtenir une sorte de gros téléfilm poussif et sans substance, équivalent pelliculé d’un hamburger joli en photo mais peu nourrissant et d’une extrême fadeur. Bien sûr, les gogos se ruent sur le spectacle comme dans les fast-food avant de constater pour certains d’entre eux que tout cela remplit à peine la fonction première. En l’occurrence, ici, divertir. Qu’y –a-t-il dans ce film ? Rien, un ennui indescriptible, des effets spéciaux tous vus et revus, des acteurs en roue libre aussi passionnés par le projet que par un tournage de pub pour un nouveau produit vaisselle et l’insondable inanité d’une… osons le mot , histoire.
Le grand bleu considéré avec papelardise par de nombreux médias comme un film générationnel n’est rien d’autre qu’un produit supplémentaire d’une génération new age entièrement fabriquée par les commerçants occupés à vendre voyages, musiques d’ambiance, parfums, bougies, matériels de plongée, etc. C’est le film idéal à projeter dans les magasins de gadgets naturalistes ou de senteurs industrielles haut de gamme (je me donne du mal pour ne pas faire de pub !) pour ceux dont le cocooning est la règle de vie. Danse avec les loups avait le mérite de revenir sur le plus grand génocide de l’histoire récente, Besson lui se fait «Nage avec les dauphins» avec une passion identique à celle suscitée par la vision d’un interlude de l’ORTF. Ça remplit les salles et les blaireaux y vont même plusieurs fois, trop contents de patauger dans une vision ‘club med’ d’un monde en apnée dont sont exclus ceux qui ne peuvent en apprécier les suaves saveurs.
Nikita, malgré un bon début pompé à Walter Hill (on ne va quand même pas citer Peckimpah en parlant de Besson !) s’enlise dans la mièvrerie au bout d’un quart d’heure (ce qui est le cas dès la première minute du grotesque Leon) et rate de fait l’option de devenir «le grand thriller français» qu’il aurait pu être. Avec Jeanne d’Arc, Besson se lance dans la reconstitution historique fantaisiste et atteint le Mont-Blanc du ridicule. La pauvre Milla Jovovich, ni anglaise ni française, ne semble pas bien comprendre ce que son amant de réalisateur veut lui faire jouer et elle se comporte comme si elle paradait pour un clip sur MTV. Quant à Dustin Hoffman, John Malkovich et Faye Dunaway, Besson doit être très content de les avoir mis dans le film et ils cachetonnent sans le moindre fluide magique qui pourrait sauver ce bourbier. N’est pas Chéreau qui veut…
Voilà pour Besson cinéaste (j’ai zappé Atlantis et Subway pour lesquels je n’ai pas de mots) et en version producteur, ça donne Taxi 1,2,3, etc, Wasabi, The Dancer et autres vilenies avec l’exception de Nil By Mouth, le film de Gary Oldman rencontré sur Leon.
Aujourd’hui, le petit rond se la joue star avec lunettes noires et coupe de douilles toujours décolorée et s’affiche sur son site internet avec l’assurance d’une figure glamour. Site internet truffé de fautes de français. Besson et ses sbires manient la langue avec autant de style que la caméra et les acteurs. Le réalisateur qui a jusqu’à présent suscité de nombreuses polémiques concernant la validité de son cinéma (tous les critiques ne sont pas aveugles ou achetés) s’en est toujours sorti par la pirouette du succès. Autrement dit : si ça marche, autant de spectateurs ne peuvent se tromper, on ne force pas les gens, c’est du cinéma de divertissement, etc, etc. La gamme d’arguments spécieux habituels qui justifient aussi le succès de la real TV, de chanteurs niais, des hommes politiques voyous, etc. Nous allons redire ici que le cinéma de Besson a du succès parce qu’il flatte les instincts du public dans le sens de la norme et qu’il est véhiculé par une massive attaque de propagande qui vaut celle de son homologue ricain, Georges Lucas.
Lucas, le mec qui a tué le cinéma américain, qui l’a confiné dans un spectacle de masses infantilisées dont les recettes de merchandising sont plus importantes que les entrées salles (Besson est en retard dans ce domaine). Lucas a crétinisé le spectateur, le distributeur, le producteur américain, a légitimé le syndrome de la séquelle, en a fait une carrière, une vie, une saga sans consistance ni justification. Lucas qui, on le sait, voulait être plus grand que Coppola. Il a vendu son âme, gagné beaucoup plus de dollars que son maître, mais ne fera jamais un film qui égalera le plus mauvais de son Pygmalion. On peut tirer les leçons que l’on veut de l’histoire hollywoodienne, mais la plus belle montre que les grandes œuvres, les moments fondateurs ne sont pas les immenses succès commerciaux (à de rares accidents près), mais les films à contre-courant, à la marge, ceux où le réalisateur, le scénariste, le producteur acceptent de prendre des risques (pas uniquement financiers) pour extirper d’un amas de pellicule des tripes et du sang, des larmes et de l’âme.
Besson a sans doute fait les mêmes choix avec la différence de sa libdo qui le pousse aux mêmes tendances que ses prédécesseurs américains. Besson fait du cinéma pour être riche, mais aussi pour tirer de belles gonzesses qu’il fait jouer dans ses films. Quand on a un physique ingrat mais du pognon et des rôles à distribuer, on constate que la recette reste toujours valable.
Comme l’année commence, qu’un vrai héros vient de disparaître (Joe Strummer), qu’un héros de cinéma s’est planté comme à la parade (Scorcese), que la succession crétine de Besson est officielle (Le pacte des sous), ce petit billet n’a d’autre fonction de rappeler au réalisateur du crépusculaire et prometteur Dernier combat qu’il est encore jeune, que la rédemption est possible, qu’il y a un sens à la vie et au cinéma autre que celui qui mène à la banque. Et que la musique sera. Malgré Serra.
Hervé Deplasse
Et une page avec des liens intéressants :
http://www.banditscompany.com/Besson.html

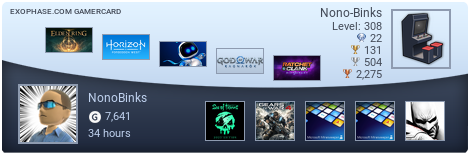



 O
O  K
K  H
H  O
O
